Atelier 1 & 2: Conclusions (Monique Adam / Georges Theis)
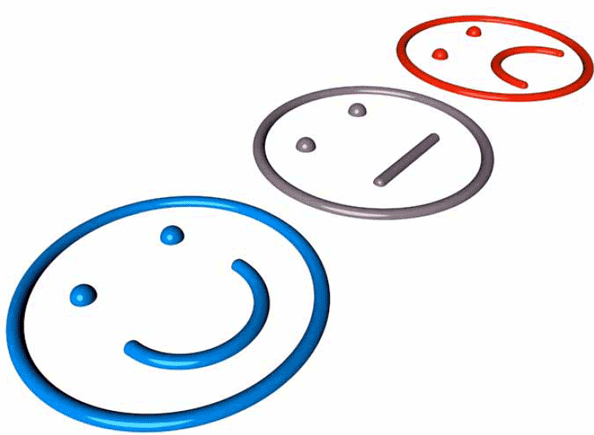
L’évaluation des systèmes scolaires etl’évaluation des écoles
Il y a des arguments pour et contre les deux formes d’évaluation:
L’autonomie des écoles demande une évaluation pour garantir des standards de qualité. Chaque école a besoin d’une évaluation en vue de vérifier le bien fondé des mesures qu’elle met en place.
L’évaluation mène inévitablement à un ranking, que ce soit au niveau des pays (PISA) ou au niveau des écoles (PRS, épreuves standardisées). Or, on compare la plupart du temps des performances qui ne sont pas comparables (curricula divers, population scolaire très hétérogène, facteurs locaux, etc.)
Il faut donc poser la question: quelle évaluation?
Pour répondre à cette question il faut d’abord connaître les objectifs. Or ceux-ci deviennent de plus en plus flous. Ni pour PISA, ni pour les épreuves standardisées au cycle 3.1, les objectifs à atteindre sont clairement définis.
L’OECD ne dit pas qu’il est inutile d’apprendre des langues étrangères, or elle n’en tient pas compte dans l’étude PISA. Elle se limite aux compétences en lecture, mathématiques et sciences naturelles. Elle affirme que les résultats dans cette étude renseignent sur les chances des jeunes à pouvoir s’insérer sur le marché du travail. Or, il n’existe pas d’étude sur les compétences demandées sur le marché du travail ou mieux sur les marchés du travail probablement différents selon les régions.
Dans la présentation du PRS aux parents d’élèves, l’Agence pour le développement de la qualité scolaire met l’accent sur la compétitivité, les écoles doivent s’adapter à une société plus exigeante et compétitive. En dehors de cette combativité, on ne trouve pas d’objectifs clairement définis.
Une évaluation pour garantir l’égalité des chances ou pour organiser la concurrence?
- Puisqu’il n’y eut aucune discussion de fond sur les grandes lignes sous-jacentes au plan d’études et aux socles de compétences, ainsi qu’aux évaluations les accompagnant, il faudrait peut-être repenser notre attitude en tant que syndicat et replacer/ accentuer nos réflexions dans le cadre plus vaste de discussions sur les tâches et missions de notre école, relancer des débats de fond sur ce point et reprendre et propager une position plus critique encore sur le fond, au lieu de se laisser entraîner par les recettes néo-libérales en vogue.
Un premier but devrait donc consister à définir clairement les missions et les objectifs de l’école et à élaborer des instruments pour l’évaluation de ces objectifs. Le but d’une telle évaluation devrait consister à s’assurer que les objectifs communs soient atteints partout. A cet effet, il faudrait accorder plus de moyens aux écoles ayant de plus grandes difficultés à atteindre ces objectifs communs. Or, actuellement le contingent limite les moyens des écoles. Le MENFP limite d’office à 20% les moyens supplémentaires pouvant être accordés à une école en milieu socioculturel défavorisé.
- Il s’agira aussi de ne plus redouter des objectifs de longue haleine - tronc commun? conservation de l’hétérogénéité dans toutes nos écoles ? rôle des différentes langues dans nos écoles et notre société? - qui, à court terme, semblent vains, utopiques, illusoires, mais qui donnent un sens au développement de l’école et aux différentes formes et mesures d’évaluation des étapes intermédiaires à définir.
Quelle autonomie pour les écoles?
- Quand doit intervenir l’évaluation? Lors de l’introduction du contingent, on assista en pratique à une diminution des moyens qui a précédé l’évaluation de pratiques existantes. Ainsi la fixation du contingent fut vécue comme arbitraire par beaucoup et l’évaluation n’a nullement joué en faveur d’une plus grande équité dans la redistribution de ressources. L’évaluation est ainsi vécue comme exercice de style imposé par une administration dans sa tour d’ivoire, sans retombées quant à l’octroi de ressources supplémentaires dont le besoin est constaté dans certaines écoles
En dehors des évaluations globales assurant la qualité à travers toutes les écoles, l’autonomie devrait permettre aux différentes écoles de se doter des moyens d’évaluation permettant de contrôler l’efficacité et la pertinence des projets qu’ils mettent en oeuvre. Il devrait s’agir d’évaluations à la carte selon les besoins des différentes écoles et réalisées à leur demande.
Monique Adam / Georges Theis
