Analyse du livre: La place de l'école dans la société luxembourgeoise de demain
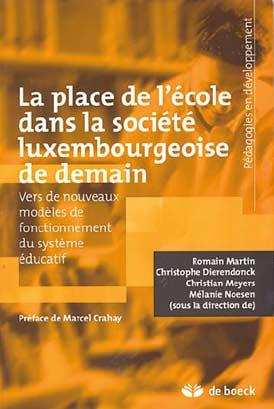
 |
Cet ouvrage fait la synthèse d'une étude financée par le Fonds National de la Recherche. Il s'adresse principalement aux acteurs nationaux de l'éducation au Luxembourg mais constitue également pour la communauté scientifique une source d'information intéressante par les analyses et les méthodologies utilisées. Nous entamons dans cette édition du SEW-Journal une lecture critique de certains chapitres du livre affiché dans le titre ci-dessus. Nous pensons en effet qu'il s'agit d'un ouvrage important basé sur une recherche fouillée, mais qu'à côté de conclusions que nous partageons, il contient un certain nombre de thèses que nous contestons. C'est à celles-ci que nous entendons réagir. Les membres de la Direction syndicale du SEW/OGBL |
Chapitre 6: Quelles conclusions peut-on tirer de l'étude PISA en ce qui concerne le fonctionnement de l'école luxembourgeoise ?
Il ne fait pas de doute pour nous que l'école luxembourgeoise ne parvient pas à niveler les différences sociales, mais qu'au contraire celles-ci se trouvent accentuées tout au long du parcours scolaire. Ceci vaut surtout pour les enfants issus de familles immigrées, mais aussi pour d'autres qui se trouvent dans une situation sociale difficile. Les résultats de l'étude PISA ont montré que l'influence de la situation socio-économique sur le niveau de compétence n'était nulle part aussi marquée qu'au Luxembourg, ce qui a incité le SEW à coopérer dès 2004 avec l'ASTI dans le « Pôle pour une école démocratique » avec l'objectif d'agir en faveur d'une meilleure égalité des chances dans l'enseignement luxembourgeois.
Nous pensons aussi, à l'instar des auteurs de ce chapitre que PISA privilégie la compréhension de textes, alors que notre système scolaire insiste particulièrement sur l'aspect formel de l'apprentissage des langues et que cette différence explique en partie les résultats négatifs de nos élèves dans ces tests. Nous ne sommes plus d'accord par contre lorsque les auteurs insinuent que les difficultés et le manque d'équité qui existent dans notre système scolaire s'expliqueraient par l'accent mis sur la maîtrise formelle de la langue. Nous ne partageons pas non plus l'idée que l'orientation lors du passage primaire-postprimaire ne se ferait pas uniquement sur la base des performances constatées en fin du primaire, mais aussi en fonction de l'arrière fond migratoire des enfants.
Il s'agit là une grave accusation lancée contre les enseignants impliqués dans la procédure d'orientation ! Voudrait-on les incriminer d'agissements xénophobes, comme on essaie déjà de leur faire porter la responsabilité pour les difficultés de leurs élèves ?
Il est clair pour nous que la langue allemande constitue un obstacle pour les élèves romanophones et nous avons été parmi les premiers qui ont confronté avec leur immobilisme face au nombre grandissant d'enfants immigrés, les responsables politiques du parti chrétien social - en charge de l'Etat et du MEN pendant pratiquement toutes les législatures de l'aprèsguerre. Mais nous sommes aussi conscients du fait que la situation linguistique de notre système scolaire est particulièrement difficile et qu'elle ressemble pour le pays tout entier à celle de certains quartiers de grandes villes étrangères, comme Berlin-Kreuzberg, avec 1/3 d'immigrés et plus.
De la présence de deux langues dans les programmes, il en résulte aussi une surcharge qui ne manque pas de se répercuter sur les résultats scolaires des plus démunis, sur l'ambiance générale dans nos écoles et partant sur l'attitude souvent négative des élèves face à l'enseignement.
Tout ceci pour dire d'une part que les résultats de PISA (et de PIRLS) doivent aussi être interprétés sous ces prémisses et d'autre part que les causes du problème et les voies de solution sont multiples et diverses.
En tant que syndicat d'enseignants tourné vers le progrès de l'école publique, nous soutenons les efforts visant à alléger les programmes pour mettre l'accent sur l'essentiel, à développer les compétences transversales de traitement de l'information et de résolution de problèmes et à promouvoir des méthodes d'enseignement diversifiées favorisant l'autonomie et la responsabilité tout en recourant à l'évaluation formative.
Mais nous sommes conscients que si l'unité de notre système scolaire doit être maintenue - avec deux langues dans l'école fondamentale - il faut au-delà de ces efforts, augmenter les moyens tant personnels que financiers à mettre à la disposition de l'enseignement et améliorer la situation sociale des familles et les structures d'aide.
Guy Foetz
Professeur de sciences économiques et sociales au LTNB
Vice-président du SEW/OGBL
Chapitre 16: Le pilotage des systèmes éducatifs
Sachant que l'unité de recherche Educational measurement and applied cognitive science (EMACS) de l'Université du Luxembourg a été désignée dans la nouvelle loi sur le SCRIPT comme l'évaluateur externe, les réflexions des acteurs centraux de cette unité de recherche sur le pilotage des systèmes éducatifs demandent à être analysées attentivement.
La discussion sur l'évaluation de la qualité dans les école y est présentée dans les termes suivants: « L'institution scolaire est aujourd'hui sommée de rendre des comptes et d'être transparente tant sur le plan de l'utilisation des fonds publics que sur la qualité de l'enseignement dispensé (p.431) ». On y trouve ensuite la métaphore des acteurs de l'aéronautique pour décrire le pilotage d'un système scolaire: le Ministère de l'Education nationale comme macro-acteur du pilotage comparable à la direction de l'aviation civile, les autorités communales et les membres de l'inspectorat sont désignés comme méso-acteurs comparables aux directions aéroportuaires, les directions d'école ou les comités d'école étant décrits comme micro-acteurs, comparables aux compagnies aériennes et les enseignants en tant que nano-acteurs étant comparables aux pilotes ayant comme responsabilité d'amener leurs passagers (élèves) à bon port (à la maîtrise des objectifs fixés par le système). L'organisme externe appelé à fournir les instruments du pilotage se situerait au centre du processus de pilotage, comme les contrôleurs aériens de la tour de contrôle des aéroports. Sa mission consisterait « à amener les différents intervenants à étudier l'efficacité de leur action au regard d'indicateurs fiables qui permettent de se situer par rapport aux finalités du système et, éventuellement, par rapport à d'autres établissements. (p.438) » Il est à noter que dans cette métaphore les élèves apparaissent comme essentiellement passifs, devant être menés à bon port par les enseignants. Dans la suite des explications sur le pilotage des systèmes scolaire on découvre malgré certaines références à « une pluralité d'instances et de lieux de régulation (p.440) » une vision foncièrement verticale du pilotage du système qui s'opère malgré des régulations multiples toujours du haut vers le bas, à savoir de l'Etat central, si ce n'est à travers un pilotage transnational par des organisations mondiales comme l'OCDE ou l'IEA, vers les acteurs de terrain.
Or, dans la réflexion sur l'amélioration de la qualité de l'école, les différents acteurs devraient avoir leur mot à dire: élèves, parents d'élèves, enseignants, autorités locales, etc. Leurs observations devraient être prises en compte pour l'amélioration du système. Or, sous une rhétorique se référant au développement scolaire se cache souvent un souci de contrôle. Il semble que l'organisme chargé de l'évaluation externe adopte plutôt cette approche.
En ce qui concerne les indicateurs mis en place pour évaluer la qualité des écoles, les écoles ont jusqu'à présent été confrontées à différentes épreuves standardisées auxquelles tous les élèves de toutes les classes d'un niveau déterminé ont participé. Depuis une dizaine d'années, il existe des épreuves standardisées réalisées au cours du deuxième trimestre de la 6e année d'études. Jusqu'à présent ces épreuves étaient surtout destinées à informer les prises de décision quant à l'orientation des élèves vers l'enseignement secondaire. Le feed-back fourni aux enseignants concernait chaque élève et le situait pour différentes compétences en mathématiques, français et allemand sur une échelle qui compare ses résultats aux résultats de tous les élèves de 6e et qui indique son score standardisé associé à un percentile (pourcentage d'élèves qui ont un score inférieur ou égal à l'élève considéré). D'après les informations fournies par le MENFP ces épreuves devraient dorénavant également servir à l'évaluation de la qualité des écoles. A partir de cette année des épreuves standardisées ont également été introduites en 3e année d'études.
Par ailleurs, les résultats de l'étude PIRLS ont été délivrés comme feedback aux différentes écoles en comparant les performances moyennes des élèves de la 5e année d'études de cette école à une moyenne nationale et aux scores moyens d'une école de référence. Or, le choix des classes de référence est resté très opaque aux classes concernées, il y en a même qui ont été comparées à différentes classes de référence, selon qu'il s'agissait des données transmises à l'enseignant ou de celles transmises à l'inspecteur. De même on a vu l'apparition de rankings, alors que le MEN a toujours affirmé que ceci n'était pas prévu.
Les auteurs du chapitre sur le pilotage des systèmes éducatifs parlent « d'indicateurs pertinents, fiables et récurrents » permettant de fonder les décisions de politique éducative. Au moins sont-ils assez honnêtes pour dire qu'il faut d'abord définir « les valeurs, les finalités et les objectifs poursuivis par le système éducatif » ce qui fait cruellement défaut à l'heure actuelle.
Et même s'ils parlent « d'un pilotage multi-niveaux, concerté et coordonné », il est clair que « la régulation verticale reste prédominante ». Il y a lieu de se demander quelle pourrait bien être cette autonomie des établissements scolaires citée à tout bout de champ, sinon celle de démontrer une plus grande efficacité dans la poursuite des buts définis à travers les évaluations mises en place ? Ne s'agit-il pas plutôt d'une vaste opération de mise en concurrence des différentes écoles pour voir où les élèves obtiennent les meilleures performances dans les tests standardisés. Dans ce cas ce sont les concepteurs des tests qui déterminent les objectifs du système éducatif. Si les différentes écoles doivent mesurer leur valeur à travers ces tests, il faudra bien qu'elles travaillent à l'amélioration de leurs résultats dans ces tests. Et qui décide du contenu de ces tests ? S'agit-il vraiment d'un débat démocratique où tous les acteurs ont leur mot à dire ou sont tout simplement à même de percevoir les enjeux ? D'ores et déjà beaucoup d'enseignants ont l'impression qu'ils n'ont aucune prise sur ces instruments à travers lesquels leur travail et celui de leurs élèves sont évalués et ceci vaut d'autant plus pour les élèves et leurs parents.
Il faut tout simplement faire confiance aux experts qui en cas de problèmes viendront les conseiller en organisant des formations continues.
En conclusion les auteurs de ce chapitre estiment que « cette définition du pilotage a permis de mettre en tension deux notions a priori paradoxales: la notion d'autonomie des acteurs, d'un côté, et, de l'autre côté, la notion d'efficacité et de contrôle de la qualité de l'enseignement ». Néanmoins, on ne voit nulle part où pourrait se situer cette autonomie des acteurs, si ce n'est dans une internalisation plus ou moins importante des finalités de l'enseignement induit par les instruments de contrôle de la qualité. Où sont les instruments permettant aux acteurs du terrain de donner un feedback sur les difficultés réellement constatées et les réponses possibles ? Où sont les moyens mis à disposition des acteurs du terrain pour analyser la pertinence des instruments du contrôle de la qualité ?
Monique Adam,
Présidente du SEW
