L'école face aux exigences de qualité, d'égalité et d'équité (Journal 1/2004)
L'école face aux exigences de qualité, d'égalité et d'équitéL'initiative « Pôle pour une école démocratique », qui rassemble notamment l'ASTI, LA FAPEL et le SEW/OGB•L a pour but essentiel d'agir en faveur d'une meilleure égalité des chances dans l'enseignement luxembourgeois. La publication, début juin 2003, du manifeste intitulé « L'inégalité des chances est le problème - clé de l'école luxembourgeoise » fut suivie à la mioctobre d'une conférence et d'un séminaire avec le Professeur Walo Hutmacher et fin décembre d'un questionnaire à l'intention des partis politiques dans le cadre de la campagne pour les élections législatives de juin 2004. Nous publions ci-dessous quelques éléments-clés de cette conférence ainsi que les questions adressées aux partis. Conférence de Walo Hutmacher, professeur de sociologie à l'Université de Genève La mondialisation accélère la compétition: de plus en plus de jeunes des pays émergeants seront bien formés, mais moins payés. Si la Chine et l'Inde augmentaient de 10% le nombre de leurs universitaires, il y en aurait 250 millions de plus ! La concurrence sera plus rude pour les « favorisés » d'ici et amènera une précarisation des défavorisés. La nouvelle génération des parents est plus exigeante, ils font dans leur vie professionnelle l'expérience de la formation tout au long de leur vie, les formes légitimes de la famille se sont diversifiées. L'école ne s'est pas encore adaptée aux deux parents qui travaillent. De nos jours, la majorité des enfants est voulue: ils constituent un « investissement » plus conscient des parents. Le paradigme éducatif a changé dans les familles: les enfants y sont élevés selon le mode de négociation, à l'école par contre on en est encore au modèle autoritaire, ce qui se traduit par l'approche frontale dans la salle de classe et le manque de droits de participation. Tout bouge autour de la l'école, les adultes mieux formés sont plus critiques vis-à-vis de l'école. Dans nos pays une option historique a été prise: l'école publique pour tous, c'est elle qui devrait garantir l'égalité des droits. Or, l'école est par excellence une fabrique d'inégalités. La sélection des élèves est en même temps un tabou et un moteur omniprésent de et à l'école. Le facteur essentiel de l'inégalité est l'origine sociale. Un constat: la difficulté de mobiliser les plus démunis: pas de comparaison avec le mouvement féministe. Les pays nordiques (Suède et Finlande) ont pris en compte l'état des inégalités il y a 25 ans ! Une politique conséquente a été mise en place depuis lors. Ce qui a frappé: les pays qui ont obtenu de bons scores dans l'étude PISA ne connaissent pas le redoublement, mais ont mis en place un éventail d'aides et d'appuis, gardent les enfants ensemble jusque vers 15 ou 16 ans. Et si l'argument économique était décisif : mieux vaut imaginer et mettre en oeuvre des mesures pour augmenter les compétences des défavorisés, de la sorte ils seront mieux outillés pour aborder le monde du travail; peu qualifiés ils risquent de coûter cher à la société: déviances, chômage, indemnités diverses, etc. Les enseignants ont perdu leur statut, leur reconnaissance. A l'instar des prolétaires ils sont dépendants d'une hiérarchie, de programmes imposés, vivent les « réformes » comme top down. Les compétences lectrices (mesurées dans l'étude PISA) ont une très forte incidence sur la formation, les revenus et le statut des personnes. Or, les résultats pour le Luxembourg n'ont pas été convaincants. Or, les chances d'obtenir un emploi à haut niveau de compétences dans le secteur tertiaire varient en fonction des compétences lectrices et du diplôme obtenu comme le montre le graphique suivant: |
Probabilité de travailler dans le secteur tertiaire à haut niveau de compétences, entre 26 et 35 ans |
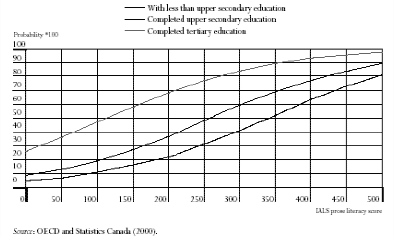 |
En matière de compétences lectrices, il existe des différences entre les autochtones et les immigrés.Pour tous les pays, on note un avantage de compétences lectrices pour les autochtones. Cependant les systèmes qui réussissent bien avec leurs autochtones font mieux aussi avec leurs immigrés. Pour le Luxembourg, dont le résultat se situe au dessous de la moyenne, les immigrés sont particulièrement désavantagés. Conclusion au sujet de la conférence Cette conférence a mis en évidence l'importance économique d'une bonne formation scolaire, tant pour l'individu que pour la société. L'inégalité des chances n'a donc pas seulement des conséquences sociales individuelles graves, mais elle mine l'avenir économique de la société. Dans un pays comme le Luxembourg, qui n'a d'autre ressource primaire que la matière grise de ses habitants, il est économiquement irresponsable d'admettre sans sourciller que 90 % de la population immigrée n'accèdent pas au diplôme de fin d'études secondaires (*) et de vouloir résoudre le problème de l'échec scolaire par une réorientation des élèves en difficulté vers des formations de niveau inférieur (**). (*) Une enquête effectuée au cours des années scolaires 1996/97 à 2000/01 par le MENFPS auprès de 2.492 bacheliers de l'enseignement secondaire révèle que 91,3 % de ces bacheliers ont principalement parlé le luxembourgeois à domicile, 2,9 % le français et 1,8 % le portugais. (**) Citons à cet égard un extrait de l'avis du SEW sur l'avant-projet de règlement grand-ducal déterminant l'évaluation et la promotion des élèves des classes du cycle inférieur et du régime préparatoire de l'EST ainsi que les conditions d'admission aux classes des différents régimes du cycle moyen: « Plutôt que de vouloir soutenir un renforcement des critères d'orientation, qui conduira sans doute à une prépondérance des formations professionnelles moins exigeantes dans le cycle moyen, nous plaidons pour un relèvement du niveau de qualification de l'ensemble des jeunes passant par notre système scolaire. Pour y réussir, il faudra - s'occuper des élèves en difficulté dès le début de leur scolarité, - prendre à bras-le-corps le problème des langues, - mettre en oeuvre dans l'enseignement technique une pédagogie plus motivante faisant appel à l'activité et à la responsabilité des élèves tout en proposant des aides individuelles à ceux-celles qui en ont besoin. Tout cela demande des investissements dans la recherche et la formation des enseignant-e-s, ainsi que dans l'équipement des écoles, soit l'engagement de vraies réformes à moyen et long terme. » |
